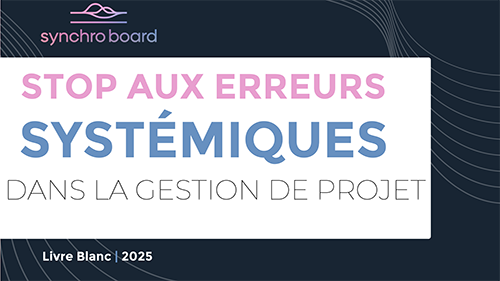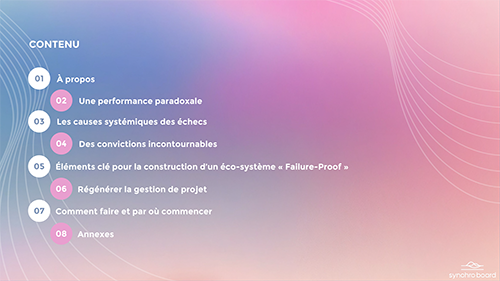SYNCHRO BOARD™
Pour ceux qui aspirent à des performances premium dans la gestion de projets complexes.
Synchro Board™ est une plateforme collaborative de nouvelle génération, conçue pour affronter les causes systémiques des défaillances de la gestion de projets.

ACCELERE LA PRISE DE DECISION
Synchroboard™ offre un cadre simple et rapide pour la mise à jour et le suivi des projets, avec stand-up meetings, langage visuel et focalisation sur le chemin critique.
Il permet à tous, managers et équipes, de vérifier instantanément l’état, les délais et la gestion des obstacles.

FACILITE LE TRAVAIL DU CHEF DE PROJET ET DES PARTICIPANTS
Avec Synchroboard, fini les emails et les appels : toutes les informations sur l’avancement des tâches et la disponibilité sont centralisées et facilement accessibles. Les mises à jour se font rapidement grâce à un système intuitif de couleurs et de symboles.

FIABILISE LA DATE DE LIVRAISON DU PROJET
Synchroboard™ place la qualité d’exécution des tâches au centre de son fonctionnement. Grâce aux techniques d’auto-qualité, les activités à risque sont encadrées par un processus de conformité rigoureux. Cela permet de prévenir les erreurs ou de les détecter rapidement, directement à la source de leur apparition.

FOCALISE L’ATTENTION DE TOUS
Synchroboard se concentre uniquement sur les tâches nécessitant une synchronisation inter-fonctionnelle, ce qui rend la gestion de projet plus claire et axée sur les priorités clés. Ses fonctionnalités permettent de gérer localement les activités spécifiques à chaque fonction, évitant ainsi de complexifier la gestion globale et de prolonger les temps de synchronisation.
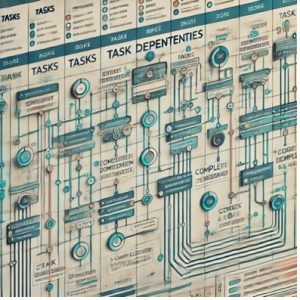
RENFORCE LA SYNCHRONISATION DES TACHES ET DES PERSONNES
Le démarrage d’une tâche dépend souvent de la fin de la tâche précédente. Synchroboard™ veille à maintenir le lien entre les tâches afin de permettre un démarrage immédiat dès la fin de la tâche précédente, quelle que soit la date. L’objectif est d’utiliser uniquement le temps strictement nécessaire pour terminer la tâche avant les délais initialement planifiés.

FAVORISE LA SYNERGIE ENTRE LES PARTICIPANTS
L’environnement conçu par Synchroboard™ met l’accent sur la priorité absolue du projet et sa progression, sans être freinée par la recherche d’optimisation des tâches individuelles ou la gestion du temps de chaque membre.

MODIFIE LA RELATION AU TEMPS
Ce qui est essentiel, c’est le temps restant pour terminer une activité, plutôt que le pourcentage d’avancement, qui est une information propre au responsable de la tâche. Synchroboard™ encourage une gestion efficace du temps en se concentrant sur la réalisation optimale de la tâche, plutôt que sur l’utilisation complète du délai initialement prévu.

DEVELOPPE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Synchroboard™ favorise un environnement où les compétences individuelles s’expriment harmonieusement pour atteindre une performance collective optimale. Les divergences d’opinions et les obstacles sont abordés de manière objective, toujours dans l’intérêt supérieur du projet.
FONCTIONALITES CLES

ECHELLE DE TEMPS DIFFERENTE ENTRE LE COURT ET MOYEN TERME
Étalement des tâches court terme sur une échelle de temps plus dilatée et au contraire, compression de l’échelle de temps pour les tâches lointaines du projet. Les échelles de temps sont paramétrables.

TACHES REGROUPEES PAR FONCTION
Chaque fonction a son « couloir » de projet dans lequel on retrouvera toutes les tâches à réaliser. Cela facilite le repérage des tâches et leur suivi.

NOMBREUX FILTRES
Synchroboard™ propose de nombreux filtres pour une meilleure réactivité et prise de décision : par fonction, par tâche, ou par personne.
Le mode ‘compressed’ permet de visualiser l’ensemble du projet d’un coup d’œil, avec accès à toutes les données en survolant chaque tâche avec la souris.

MISE A JOUR
Possibilité d’ajouter ou de retrancher des milestones ou des tâches à n’importe quel moment du projet.

MISE A JOUR DU SYNCHROBOARD
La progression des tâches se fait facilement et en temps réel par drag-&-drop.
Plusieurs personnes peuvent intervenir simultanément.

SAUVEGARDE SECURISEE
Google Cloud Platform (GCP) est utilisé pour sa grande sécurité, tant en matière de cybersécurité que de sauvegarde des données.
Le code source est sécurisé sur GitHub et reste accessible à tous les clients enregistrés en cas de défaillance de l’infrastructure externe.

PERSONNALISATION
Synchroboard™ s’intègre facilement avec les applications de gestion de projet déjà en place, garantissant une compatibilité fluide. De plus, il est possible de personnaliser l’interface avec votre charte graphique pour une expérience adaptée à vos besoins.
Il est également possible d’ajouter ou de supprimer des jalons ou des activités à tout moment durant le projet.
TEMOIGNAGES CLIENTS
Luca C.
Nous étions en plein processus d’application des méthodologies lean aux processus de conception, avec pour objectif de réduire le délai de mise sur le marché d’un nouveau produit. Nous avons planifié avec les compétences disponibles, en essayant d’anticiper les retards et de mettre en place des actions correctives préventives. Malgré cela, nous avons rapidement accumulé du retard.
C’est à ce moment-là que nous avons introduit le concept de Syncro Board. Les projetteurs étaient sceptiques, et le chef de projet craignait d’aggraver les retards. Cependant, les résultats ont dépassé toutes les attentes : en quatre semaines, non seulement nous avons rattrapé le retard, mais nous étions en avance sur le planning initial. Nous avons achevé le projet avec quatre semaines d’avance sur les 24 semaines prévues, soit un gain remarquable de 16,6 % sur le délai de mise sur le marché.
À l’époque, j’étais directeur du département Lean et Opérations Stratégiques chez FAAC SpA. Aujourd’hui, je travaille dans le domaine de l’organisation d’entreprise, et l’approche Syncro Board est devenue un outil indispensable dans cette démarche.
Didier P.
“Grâce à une échelle de temps adaptée entre le court et le moyen terme, SYNCHROBOARD nous a permis de rester concentrés sur les activités et de respecter nos engagements. En compressant les tâches et réduisant les temps morts, il nous a aidés à décrocher une commande supplémentaire initialement attribuée à un concurrent en retard”
Saverio G.
“SYNCHROBOARD a transformé notre rapport au temps et à la gestion de projet. Il a apporté de la clarté là où il y avait des zones d’ombre, fédéré les énergies pour respecter nos engagements, et surtout, il a réduit considérablement le temps perdu à corriger les anomalies en phase de montage.”
Projeteur Mecanicien
“Je venais tout juste de terminer une formation en gestion de projet lorsque SYNCHROBOARD a été intégré dans l’entreprise. J’ai découvert une interprétation inéditedes concepts de gestion de projet traditionnels. J’en suis enchanté”
Michele D.
“Nous avions remis en question notre gestion de projet à plusieurs reprises sans jamais obtenir de résultats réellement meilleurs. SYNCHROBOARD nous a conquis par sa capacité à simplifier la gestion de projets complexes. Nous pensions qu’une application sophistiquée était nécessaire pour gérer nos produits complexes, mais SYNCHROBOARD nous a surpris en proposant de ‘découper le projet en petites parties’ et de les gérer simplement avec un outil très basique. C’est cette simplicité qui nous a étonnés et séduits.”
Marco T.
"Malgré un time to market très serré, SYNCHROBOARD nous a permis de démarrer la production à temps avec beaucoup moins de problèmes par rapport au passé, tout en respectant les coûts cibles et le budget du projet. On a tous été surpris du résultat."
DECOUVREZ QUI NOUS SOMMES
Notre Mission

« Concevoir pour les clients les plus exigeants, un écosystème capable d’affronter avec succès les causes profondes des échecs dans la gestion de projets, afin de garantir de manière systématique l’atteinte des objectifs fixés. »
Synchro board Team.
Notre parcours vers Synchro board™
Nous sommes, avant tout, des consultants qui accompagnent les PME et les grandes entreprises en Europe et dans le monde depuis plus de 25 ans pour améliorer leurs performances opérationnelles et stratégiques.
La gestion de projets, au cœur de nombreux processus sur lesquels nous intervenons, est devenue une priorité.
Nous avons donc concentré nos efforts sur l’amélioration des performances dans la gestion de projets, en identifiant et résolvant les causes systémiques des échecs.
De cette vision est né Synchroboard™, fruit de plus de 10 ans de développement et d’améliorations constantes, réalisées en collaboration avec nos clients.
Et ce n’est que le début : il reste encore de nombreux défis et opportunités à saisir.
Synchroboard™ continuera à évoluer, avec de nouvelles versions déjà en préparation.

Nos convictions pour concevoir Synchro board™

Les principes fondamentaux du lean doivent servir de base à la conception de Synchroboard™, afin de garantir un niveau de performance premium.
Les concepts issus de la méthodologie agile ont largement prouvé leur pertinence et leur efficacité en gestion de projet. Nous les avons adaptés pour qu’ils s’intègrent harmonieusement avec d’autres outils et méthodologies.
Les bonnes pratiques, héritées de multiples expériences et validées au fil du temps, constituent des enseignements précieux. Nous les avons confrontées à Synchroboard™ pour identifier et corriger les écarts ou lacunes observés.
Enfin, nous avons remis en question les acquis et enseignements en gestion de projet afin de corriger les causes systémiques d’échec ou d’insuccès dans ce domaine.
Synchro board™ : Notre solution pour aborder les causes récurrentes des défaillances dans la gestion de projet.
Ce qui rend Synchro board™ unique, c’est l’intégration de trois sphères essentielles :

- Les connaissances techniques et convictions acquises, basées sur une expertise approfondie.
- Les savoir-faire pratiques et organisationnels, développés à travers des expérimentations concrètes.
- L’intelligence émotionnelle, qui inclut la capacité à gérer ses émotions et à interagir efficacement avec les autres.
Nous sommes convaincus que l’interaction de ces trois sphères est la clé d’une performance supérieure, incarnant l’intelligence collective. C’est cette intelligence collective qui permet de résoudre un grand nombre de causes systémiques d’échec en gestion de projet.
Bien plus qu’une simple application de gestion de projet, Synchroboard™ est un véritable méta-outil. Il est conçu pour s’intégrer au cœur des processus stratégiques, qu’il s’agisse de développement de nouveaux produits, de personnalisation à la demande ou de tout contexte nécessitant une gestion rigoureuse du temps et des ressources.

Quelques-unes de nos références














RESSOURCES
12 lois et pratiques pour s’assurer de réussir la gestion de projet
La gestion de projet est une discipline complexe où chaque étape nécessite une planification rigoureuse et une exécution méthodique.
Pour maximiser ses chances de succès, il est essentiel d’intégrer les lois et les bonnes pratiques communément établies.
Ces principes, développés à partir de décennies d’expérience, permettent d’anticiper les obstacles, de gérer efficacement les ressources et de garantir des résultats cohérents.
En adoptant ces principes, les chefs de projet réduisent les incertitudes et augmentent la capacité de l’équipe à répondre aux imprévus.
Le respect des lois et des bonnes pratiques garantit une structure solide et permet de transformer un projet complexe en une réussite mesurable, tout en optimisant le temps et les ressources investis.
Ces lois ont été intégrées dans l’écosystème Synchroboard™. Nous vous en proposons notre interprétation personnelle ci-dessous.
Bien sûr, il existe d’autres lois, aphorismes, dictons et maximes qui se passent d’explications tant leur évidence parle d’elle-même.
Je souhaiterais citer, par exemple :
- « MOONSHINE », attribuée à mon senseï Akao San :
« Ne perds pas de temps à expliquer ce que tu veux faire et pourquoi à tes chefs. Ils ne connaissent pas le gemba. Fais sans rien dire et montre ensuite ce que tu as réalisé. Tu entendras alors tes chefs dire : “C’est exactement ce que je voulais que tu fasses.” »
- « La vitesse importe peu, ce qui compte, c’est d’aller dans la bonne direction. », une maxime de Lord Baden Powell, le fondateur du scoutisme, qui disait également à propos du leadership : « Si tu cours, ils marchent. Si tu marches, ils s’assoient. Si tu t’assois, ils se couchent. »
Enfin, quelques lois attribuées à AMA, un consultant senior que je connais bien :
- « On est toujours plus expert pour régler les problèmes des autres que pour les siens propres, pour lesquels on a plein de justifications. »
- Son corollaire : « On est toujours moins tolérant envers les autres qu’envers soi-même. »
- « La différence entre explication et justification est la même que celle entre ceux qui améliorent et ceux qui restent dans le statu quo. »
- « C’est une folie de penser être utile en consacrant du temps à essayer de faire avec moins de compétences ce qu’un collègue n’a pas fait par manque de temps. »
Bien sûr, il existe d’autres lois, aphorismes, dictons et maximes qui se passent d’explications tant leur évidence parle d’elle-même.
Je souhaiterais citer, par exemple :
- « MOONSHINE », attribuée à mon senseï Akao San :
« Ne perds pas de temps à expliquer ce que tu veux faire et pourquoi à tes chefs. Ils ne connaissent pas le gemba. Fais sans rien dire et montre ensuite ce que tu as réalisé. Tu entendras alors tes chefs dire : “C’est exactement ce que je voulais que tu fasses.” »
- « La vitesse importe peu, ce qui compte, c’est d’aller dans la bonne direction. », une maxime de Lord Baden Powell, le fondateur du scoutisme, qui disait également à propos du leadership :
« Si tu cours, ils marchent. Si tu marches, ils s’assoient. Si tu t’assois, ils se couchent. »
- Enfin, quelques lois attribuées à AMA, un consultant senior que je connais bien :
- « On est toujours plus expert pour régler les problèmes des autres que pour les siens propres, pour lesquels on a plein de justifications. »
- Son corollaire : « On est toujours moins tolérant envers les autres qu’envers soi-même. »
- « La différence entre explication et justification est la même que celle entre ceux qui améliorent et ceux qui restent dans le statu quo. »
- « C’est une folie de penser être utile en consacrant du temps à essayer de faire avec moins de compétences ce qu’un collègue n’a pas fait par manque de temps. »
Ces lois et maximes, bien qu’apparemment simples, renferment une sagesse précieuse pour guider nos actions et notre réflexion au quotidien.
La Loi de Murphy : “Tout ce qui peut mal tourner, tournera mal.”
La loi de Murphy est un adage populaire qui stipule : “Tout ce qui peut mal tourner, tournera mal.” Bien qu’elle soit souvent vue comme une remarque humoristique ou pessimiste, elle reflète une réalité importante dans de nombreux domaines, notamment en gestion de projet.
Par expérience, j’ai apporté une variante plus réaliste encore à l’expression : “Tout ce qui peut mal tourner, tournera mal et dans la pire des situations.”!
Origine de la loi de Murphy
La loi tire son nom d’Edward A. Murphy Jr., un ingénieur en aéronautique américain qui travaillait sur des tests de tolérance humaine à la gravité dans les années 1940.
Lorsqu’un dispositif mal installé causa l’échec d’une expérience, Murphy aurait déclaré : “Si quelqu’un peut faire une erreur, il la fera.” L’expression a depuis été abrégée en sa forme actuelle.
Exemples concrets de la loi en gestion de projet
- Retard dans les livraisons : Si un fournisseur peut être en retard, il y a de fortes chances qu’il le soit et au pire des moments.
- Bugs logiciels : Une nouvelle mise à jour, même minutieusement préparée, pourrait provoquer des dysfonctionnements inattendus au pire des moments.
- Malentendus avec les parties prenantes : Si une communication peut être mal interprétée, elle le sera probablement au pire des moments.
Comment contrer la loi de Murphy ?
Un corollaire à cette loi bien connu nous guide vers la solution : “le diable est dans les détails” une expression courante qui signifie que les petites particularités, souvent négligées, peuvent être sources de problèmes ou de complications.
En d’autres termes, ce sont les détails qui, s’ils sont mal gérés, risquent de causer des difficultés imprévues et donc de laisser le champ libre à la loi de Murphy.
3 préconisations à prendre en compte :
- Soigner la préparation du projet en faisant une analyse de risques sur les thèmes de la qualité, des couts, des délais et de la performance de la solution
- Découper le produit à concevoir ou à fabriquer en éléments/modules tels qu’il soit possible d’en vérifier le bon fonctionnement sans attendre la phase ultime, au moment de l’exécution des travaux ou pire de l’installation auprès du client pour découvrir les erreurs
- Lorsque la loi de Murphy a pu s’appliquer, analyser finement quelles ont été les causes racines, trouver la parade et corriger les carences dans les processus ou les comportements.
La loi de Parkinson : “Un travail occupe toujours tout le temps disponible pour son accomplissement.”
La loi de Parkinson, formulée par Cyril Northcote Parkinson en 1955, énonce que “le travail s’étend de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement.”
En d’autres termes, plus on dispose de temps pour accomplir une tâche, plus on a tendance à le prendre, souvent au détriment de l’efficacité.
Application de la loi de Parkinson en gestion de projet :
- Dilution des efforts :
En gestion de projet, la loi de Parkinson explique pourquoi les équipes peuvent ralentir leur rythme lorsqu’un délai généreux est accordé.
Elles ajustent leur cadence, étendant inutilement le temps nécessaire pour compléter des tâches simples.
Exemple :
Si une tâche estimée à 3 jours est planifiée sur une semaine, il est probable qu’elle prenne réellement une semaine, car les équipes adapteront leur effort au temps disponible.
- Procrastination et inefficience :
Lorsque les membres d’une équipe savent qu’ils ont beaucoup de temps pour une tâche, ils peuvent retarder son démarrage ou se concentrer sur des aspects non prioritaires.
- Risque d’ajout non nécessaire :
Avec plus de temps, les équipes pourraient inclure des fonctionnalités ou des détails supplémentaires non essentiels, ce qui complique inutilement le projet.
Conséquences en gestion de projet :
- Risque de dépassement des délais : Même avec un calendrier bien défini, les tâches peuvent s’étendre, impactant les jalons du projet.
- Coûts additionnels : Plus une tâche prend du temps, plus elle mobilise des ressources, augmentant les dépenses.
- Manque de productivité : La dilution du travail crée une perception d’inefficacité dans l’équipe.
Comment contrer la loi de Parkinson ?
- Fixer des délais réalistes et serrés :
Accorder juste assez de temps pour accomplir une tâche encourage les équipes à se concentrer et à travailler efficacement.
- Utiliser des jalons intermédiaires :
Diviser un projet en étapes avec des délais clairs pour maintenir un rythme constant.
- Favoriser des approches agiles :
Des cycles courts et des livrables fréquents (comme dans la méthodologie Agile) limitent la tendance à diluer le travail sur de longues périodes.
- Encourager la responsabilisation :
Instaurer un suivi régulier et une communication transparente pour s’assurer que les équipes restent alignées sur les objectifs.
- Changer la signification de la durée d’une tâche :
La durée d’une tâche dépend de plusieurs facteurs : focalisation, multi-tâche, expérience, niveau de performance attendu, etc.
Cette estimation varie souvent entre optimistes et pessimistes, avec une dispersion qui peut aller du simple au double.
Peu importe cette dispersion si l’objectif final reste clair : consommer le moins de temps possible.
Pour contrer la loi de Parkinson, il faut reconnaître qu’il est statistiquement improbable que le temps estimé corresponde exactement au temps réellement nécessaire.
Cela laisse deux scénarios possibles :
- La tâche est terminée avant la date prévue.
- La tâche est terminée après la date prévue.
C’est pourquoi Synchroboard™ a supprimé la couleur « verte », souvent utilisée en gestion de projet pour indiquer qu’une tâche est terminée, car elle ne reflète pas cette réalité.
Le temps alloué à une tâche n’est pas un budget à dépenser. Ce temps appartient au projet, pas à la personne qui exécute le travail.
Conclusion :
La gestion du temps dans un projet ne doit pas être perçue comme une simple allocation à consommer, mais comme une ressource précieuse à optimiser au service des objectifs globaux.
En adoptant une approche réaliste et flexible, comme celle proposée par Synchroboard™, il devient possible de réduire les écarts liés aux estimations et d’orienter les équipes vers une gestion plus efficace et centrée sur les priorités.
Cette vision rappelle que chaque tâche doit servir le projet, et non l’inverse, pour garantir un véritable gain en performance et en efficacité.
Loi de Hofstadter : “Tout prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter.”
“Il faut toujours plus de temps qu’on ne le pense, même en tenant compte de la loi de Hofstadter.”
Cette loi souligne une vérité universelle : les projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, prennent souvent plus de temps que prévu, même lorsque l’on essaie d’anticiper les retards.
Origine et Contexte
Douglas Hofstadter a proposé cette loi dans le cadre de la résolution de problèmes complexes, comme la création d’intelligences artificielles ou d’algorithmes. Cependant, sa portée dépasse largement ce domaine et s’applique à de nombreux contextes où la planification est essentielle.
Causes principales derrière la loi de Hofstadter :
- Sous-estimation systématique des tâches :
Les humains ont tendance à être trop optimistes quant à leur capacité à accomplir des tâches, négligeant les détails et les imprévus.
- Complexité des projets :
Même les projets qui semblent simples peuvent cacher des dépendances ou des problèmes imprévus.
- Effet d’auto-référence :
La loi elle-même souligne qu’essayer de compenser les retards en ajustant les prévisions ne suffit pas, car les imprévus continuent de surgir.
Implications en gestion de projet :
La loi de Hofstadter a des conséquences importantes dans la planification des projets, notamment :
- Dépassement des délais : Les retards deviennent presque inévitables, même avec une planification minutieuse.
- Effet boule de neige : Les retards sur certaines tâches critiques peuvent entraîner des impacts sur l’ensemble du projet.
- Frustration des parties prenantes : La difficulté à respecter les échéances peut affecter la confiance des clients ou des parties prenantes.
Comment atténuer les effets de la loi de Hofstadter ?
- Ajout de marges de sécurité non pas sur chaque tâche mais sur un ensemble de tâches liées les unes aux autres pour délivrer un sous produit du projet :
Incorporer des tampons de temps pour faire face aux imprévus, en tenant compte de l’expérience passée. Il s’agit d’un coussin qui doit garantir la disponibilité des livrables à la date prévue pour permettre aux tâches suivantes de ne pas prendre de retard. Cela est similaire au concept de supermarché pour le système de production en juste-à-temps (JIT)
- Décomposition des tâches :
Diviser un projet en petites étapes pour mieux évaluer le temps requis pour chacune. Ce faisant, on est beaucoup plus précis dans ses attributions et ses prévisions
- Analyse des risques :
Identifier les tâches critiques et les dépendances susceptibles de causer des retards d’une part et définir les actions de mitigation des risques d’autre part. Ce dernier point est souvent éludé ou mal monitoré.
- Flexibilité dans la planification :
Étant donné que les tâches ne peuvent être achevées qu’avant ou après leur date initialement prévue, cela impose une replanification régulière des tâches suivantes.
Cette démarche permet de maintenir une synchronisation précise entre la date de fin d’une tâche prédécesseur et la date de démarrage de la tâche successeur.
C’est cette nécessité de synchronisation constante qui a inspiré le nom de notre application : Synchroboard™.
- Approches itératives :
Augmenter la fréquence des revues de progression et organiser la structuration de projet pour livrer des résultats intermédiaires, réduisant ainsi l’impact des retards globaux.
Conclusion :
La loi de Hofstadter est un rappel puissant que les imprévus et les complexités sont inhérents à tout projet.
Plutôt que de viser une planification parfaite, il est essentiel d’adopter une gestion flexible et proactive pour mieux répondre aux défis imprévus.
La loi 90-90 : “Le premier 90% du projet nécessite 90% du temps, et les 10% restants nécessitent également 90% du temps.”
La loi 90-90, souvent citée de manière humoristique dans le domaine du développement logiciel et de la gestion de projet, énonce :
“Les premiers 90 % d’un projet prennent 90 % du temps prévu, et les 10 % restants prennent aussi 90 % du temps.”
Interprétation et Portée :
Cette loi met en évidence un phénomène bien connu dans les projets complexes : la sous-estimation des efforts nécessaires à la dernière partie du travail.
Elle illustre comment les tâches finales, souvent perçues comme secondaires ou rapides à accomplir, finissent par être beaucoup plus chronophages et compliquées que prévu.
- Premiers 90 % : Correspondent généralement aux étapes initiales, telles que la conception, le développement ou l’exécution des grandes lignes du projet. Ces phases sont souvent bien planifiées et exécutées en grande partie selon le calendrier prévu.
- Derniers 10 % : Concernent les ajustements, les corrections, les tests, les validations et les petites finitions. Ces étapes sont souvent ralenties par des imprévus, des changements de dernière minute ou des problèmes non anticipés.
Causes Principales de la Loi 90-90 :
- Sous-estimation des finitions :
Les “petits détails” (tests, corrections de bugs, validation finale) sont souvent mal évalués en termes de temps et d’effort.
- Complexité croissante :
À mesure que le projet avance, les interdépendances et les défis deviennent plus visibles, rendant les ajustements plus complexes.
- Pression accrue :
Les derniers 10 % d’un projet coïncident souvent avec la proximité de la date limite, augmentant le stress et la probabilité d’erreurs.
Exemples d’application :
- Développement logiciel : Les premières étapes, comme l’écriture du code principal, progressent rapidement, mais les tests finaux, la correction des bugs et le déploiement prennent beaucoup plus de temps que prévu.
- Construction : La structure principale peut être achevée dans les temps, mais les finitions (peinture, électricité, décoration) retardent souvent la livraison.
- Gestion de projet : Même lorsque les grandes étapes semblent complétées, les ajustements finaux pour satisfaire toutes les parties prenantes peuvent être longs.
Comment contrer la Loi 90-90 ?
- Planification minutieuse :
Comme pour la loi de Hofstadter, inclure des « supermarchés » pour chaque sous-produit du projet et à la fin du projet, un « supermarché » pour l’ensemble du projet. Ce temps est celui qui sépare la date de fin de la dernière tâche du projet et la date de livraison effective. Dans Synchroboard, nous appelons ce temps « la banque du temps ». Un indicateur spécifique suit son évolution pour s’assurer qu’il n’est pas plus rapidement consommé que n’avance le projet. C’est en quelque sorte le « Burn-Down Chart » de la méthodologie agile
- Anticipation des détails :
Accorder plus d’attention à l’évaluation des finitions et prévoir suffisamment de temps pour les tests, corrections et ajustements.
- Itérations régulières :
Livrer progressivement des parties du projet pour identifier et corriger les problèmes dès le début, plutôt que d’attendre la fin.
- Gestion proactive des risques :
Identifier les points critiques susceptibles de retarder les dernières étapes.
Conclusion :
La loi 90-90 est une manière humoristique mais réaliste de rappeler qu’en gestion de projet, les détails de fin de parcours sont souvent plus coûteux en temps et en effort qu’on ne le pense.
Une planification efficace et une anticipation des imprévus peuvent aider à réduire l’impact de ce phénomène.
La loi de Brooks : “L’ajout de ressources humaines à un projet en retard le retardera davantage.”
La loi de Brooks, formulée par Fred Brooks dans son livre classique The Mythical Man-Month (1975), est un principe fondamental de la gestion de projet, en particulier dans le développement logiciel. Elle affirme :
“Ajouter des effectifs à un projet en retard ne fait que le retarder davantage.”
Explication :
La loi de Brooks met en évidence les limites de l’ajout de ressources humaines à un projet en difficulté.
Contrairement à l’idée reçue qu’un travail peut toujours être accéléré en ajoutant plus de personnes, la réalité montre que cela entraîne souvent une perte de productivité pour plusieurs raisons :
- Temps d’intégration :
Les nouveaux membres de l’équipe doivent être formés et mis à jour sur l’état du projet, ce qui mobilise du temps et des ressources des membres déjà en place.
- Complexité accrue de la communication :
À mesure que le nombre de personnes augmente, les efforts de coordination croissent de façon exponentielle, rendant la communication et la prise de décision plus difficiles.
- Tâches indivisibles :
Certains aspects d’un projet (comme la conception ou la résolution de problèmes complexes) ne peuvent pas être divisés entre plusieurs personnes.
Ajouter des effectifs n’apporte donc aucun bénéfice.
Contexte et Applications :
- Développement logiciel :
Brooks a observé cette loi dans des projets de grande envergure, où les délais étaient aggravés par l’ajout de développeurs, en raison des défis liés à la coordination et à l’intégration.
- Gestion de projet en général :
La loi s’applique également à d’autres secteurs, où l’ajout de ressources humaines dans un contexte mal structuré ou en retard provoque davantage de désorganisation.
Exemple concret :
Imaginez un projet en retard où 5 développeurs travaillent sur une application complexe. Ajouter 3 nouveaux développeurs obligera les 5 premiers à :
- Former les nouveaux venus.
- Répartir le travail et gérer les dépendances.
Cela ralentira leur propre rythme de travail, augmentant temporairement les retards.
Solutions pour contrer la Loi de Brooks :
- Mieux planifier dès le départ :
Anticiper les besoins en ressources humaines et définir des marges de sécurité réalistes.
C’est une évidence et pourtant, on le voit très souvent combien cette notion est mal évaluée.
- Modulariser les tâches :
Découper les projets en sous-systèmes indépendants pour permettre à de nouveaux membres d’intervenir sans perturber l’ensemble.
En ce sens, cette modularité devrait recopier la modularité du produit objet du projet ce qui est aujourd’hui un prérequis pour la compétitivité
- Améliorer les outils et processus :
Utiliser des outils de gestion de projet qui facilitent la collaboration et réduisent les efforts de communication.
En ce sens, Synchroboard est remarquable.
Son système visuel est extrêmement performant. Il permet en moins d’une minute de savoir même pour une personne extérieure au projet, si ce dernier est correctement géré ou pas
- Revoir l’échéancier :
Dans certains cas, il est préférable d’accepter un retard et de réorganiser le travail plutôt que de surcharger l’équipe.
C’est fondamental et fait partie intégrante des pratiques enseignées dans l’écosystème Synchroboard
Conclusion :
La loi de Brooks rappelle que les projets complexes ne peuvent pas toujours être accélérés simplement en ajoutant des effectifs.
La loi de Humphrey : “Les utilisateurs ne savent pas ce qu’ils veulent avant de le voir.”
La loi de Humphrey, attribuée à Watts Humphrey, un pionnier de l’ingénierie logicielle et créateur du Capability Maturity Model (CMM), affirme :
“Les utilisateurs ne savent pas ce qu’ils veulent avant de le voir.”
Interprétation :
La loi de Humphrey met en lumière une difficulté fondamentale du développement de produits et, en particulier, du développement logiciel : les besoins des utilisateurs sont souvent mal définis ou évolutifs. Même lorsque les exigences initiales sont explicitement exprimées, elles peuvent être imprécises ou inadéquates pour répondre aux besoins réels.
Causes sous-jacentes de la loi :
- Vision limitée des utilisateurs :
Les utilisateurs, sans une démonstration concrète, peuvent avoir du mal à visualiser comment un produit ou une solution répondra à leurs besoins.
- Évolution des attentes :
À mesure qu’un projet progresse, les utilisateurs acquièrent une meilleure compréhension de leurs besoins réels, souvent différents de leurs attentes initiales.
- Complexité des projets :
Les systèmes logiciels, en particulier, sont souvent si complexes que leurs interactions ou fonctionnalités ne peuvent être entièrement comprises avant leur implémentation.
Implications en gestion de projet et développement logiciel :
- Dérive des exigences :
Les changements fréquents des besoins des utilisateurs (parfois appelés scope creep) peuvent entraîner des retards, des dépassements de budget et des frustrations.
- Communication insuffisante :
La loi souligne l’importance d’une communication continue entre l’équipe de développement et les utilisateurs pour réduire les malentendus.
- Prototypage essentiel :
Elle justifie l’utilisation de maquettes, de prototypes ou de versions préliminaires pour permettre aux utilisateurs de “voir” et d’affiner leurs attentes.
Approches pour gérer la Loi de Humphrey :
- Méthodologies Agile :
Les approches comme Scrum ou Kanban permettent de livrer des versions incrémentales du produit pour recueillir les retours des utilisateurs et ajuster rapidement les fonctionnalités. Attention toutefois car cette approche appelée « incrémentale et itérative », si elle est détournée de son sens premier deviendrait contre productive. Cette approche ne doit pas faire l’économie d’une véritable exploration des besoins et de leur poids respectifs ce que fournit très bien l’approche remarquable de la Quality Function Deployment (QFD).
- Prototypage rapide :
Créer des maquettes ou des prototypes fonctionnels pour permettre aux utilisateurs de tester et affiner leurs attentes dès le début du projet.
- Ateliers collaboratifs :
Impliquer activement les utilisateurs dans les phases de conception pour réduire l’écart entre leurs besoins réels et exprimés.
- Tests utilisateurs fréquents :
Organiser des sessions de test avec des utilisateurs réels tout au long du projet pour valider les fonctionnalités en cours de développement.
Conclusion :
La loi de Humphrey est un rappel puissant que les projets doivent être flexibles et centrés sur les utilisateurs.
En utilisant des méthodologies adaptées et en collaborant étroitement avec les parties prenantes, les équipes peuvent minimiser les incertitudes et répondre aux besoins réels des utilisateurs, même lorsqu’ils évoluent au fil du temps.
La prise en compte de l’évolution des besoins ne doit en aucune manière rallonger la durée globale du projet.
La loi de la complexité : Plus un projet est complexe, plus il y a de points potentiels d’échec.
La loi de la complexité, bien qu’elle ne soit pas formellement énoncée comme une “loi” unique, fait référence à l’idée que la complexité d’un système ou d’un projet tend à croître avec le temps, souvent de manière exponentielle, à mesure que des éléments supplémentaires y sont intégrés.
Une formulation possible de cette idée est la suivante :
“La complexité augmente avec l’échelle d’un projet ou d’un système, et chaque ajout rend la gestion et la compréhension plus difficiles.”
Origine et Contexte :
Cette loi s’appuie sur des principes observés dans divers domaines, tels que :
- La gestion de projet : Où chaque tâche ou dépendance ajoutée accroît la difficulté de coordination.
- Le développement logiciel : Où chaque nouvelle ligne de code, fonctionnalité ou correction de bug peut introduire des interdépendances et des risques.
- Les systèmes complexes en général : Où des interactions imprévues apparaissent lorsque le système devient plus large ou plus sophistiqué.
Principaux concepts liés à la loi de la complexité :
- Croissance exponentielle de la communication :
Lorsque la taille d’une équipe ou d’un projet augmente, le nombre de canaux de communication croît de manière exponentielle, selon la formule n(n-1)/2, où n est le nombre de membres. Cette complexité accrue rend la coordination plus difficile et augmente le risque de malentendus.
- La “dette technique” :
Dans le développement logiciel, chaque modification rapide ou non planifiée peut ajouter de la complexité au système, nécessitant des efforts supplémentaires pour maintenir ou améliorer le code à long terme.
- Entropie organisationnelle :
Dans les organisations ou les projets, à mesure que des règles, des processus ou des outils supplémentaires sont introduits, le système peut devenir plus rigide, plus lent et plus difficile à gérer.
- Loi des rendements décroissants :
Au fur et à mesure que des éléments sont ajoutés pour résoudre un problème ou améliorer un système, les bénéfices obtenus deviennent de moins en moins significatifs par rapport à l’effort supplémentaire requis.
Implications de la loi de la complexité en gestion de projet :
- Difficultés de coordination :
Plus un projet est grand et complexe, plus il devient difficile d’aligner les efforts des différentes parties prenantes.
- Risque accru d’erreurs :
Avec l’augmentation des interdépendances, une erreur mineure peut avoir des conséquences disproportionnées sur le projet global.
- Augmentation des délais et des coûts :
La complexité ajoute des couches supplémentaires de travail (planification, communication, correction), ce qui impacte les délais et les budgets.
Comment gérer la complexité ?
- Simplification proactive :
- Découper les projets ou systèmes en modules indépendants.
- Réduire les dépendances entre les tâches.
- Priorisation des tâches essentielles :
Se concentrer sur les éléments à forte valeur ajoutée et éviter les ajouts inutiles qui augmentent la complexité sans bénéfices clairs.
Ce point est crucial dans les tableaux utilisés dans l’application Synchroboard™ où seules les tâches qui concernent deux ou plus parties prenantes (en général les métiers ou fonctions) sont gérées.
Le stâches internes à chaque fonction sont gérées localement pour ne pas disperser l’attention du chef de projets et des parties prenantes sur les tâches essentielles à l’atteinte des objectifs du projet
- Automatisation et outils adaptés :
Utiliser des outils de gestion pour simplifier les processus et améliorer la communication.
- Méthodologies agiles :
Adopter des approches flexibles comme Scrum, qui favorisent des cycles courts et des ajustements fréquents, réduisant ainsi les risques liés à la complexité accumulée.
- Documentation rigoureuse :
Maintenir une documentation claire et à jour pour permettre une meilleure compréhension et gestion des systèmes complexes.
Conclusion :
La loi de la complexité rappelle que tout système ou projet, s’il n’est pas activement simplifié, tend à devenir de plus en plus difficile à comprendre et à gérer.
En intégrant des pratiques adaptées et en restant attentif à l’équilibre entre innovation et stabilité, il est possible de limiter les impacts négatifs de la complexité croissante.
La loi de Maier : Si le problème n’est pas bien défini, la solution le sera également.
La Loi de Maier, formulée par l’ingénieur et spécialiste des systèmes Robert Maier, est un principe souvent cité en ingénierie des systèmes et en gestion de projet. Elle stipule :
“Si le problème n’est pas clairement défini, la meilleure solution ne peut pas être identifiée.”
Interprétation :
La loi de Maier met en lumière un aspect fondamental de la résolution de problèmes : l’importance cruciale de la compréhension claire et précise du problème avant de chercher des solutions.
Un problème mal défini entraîne des solutions inefficaces ou inappropriées, souvent coûteuses en temps et en ressources.
Causes fréquentes de problèmes mal définis :
- Manque de clarté des objectifs :
Les parties prenantes ne s’accordent pas sur ce qu’elles veulent accomplir.
- Compréhension erronée :
Les besoins des utilisateurs ou des clients ne sont pas bien compris ou exprimés.
- Complexité ou ambiguïté du problème :
Les aspects critiques du problème sont masqués par des détails secondaires ou mal priorisés.
- Hypothèses implicites :
Les parties prenantes ou les équipes supposent connaître le problème sans l’avoir explicitement analysé.
Application en gestion de projet :
- Importance de la définition des exigences :
En gestion de projet, un problème mal défini peut conduire à des spécifications floues, ce qui rend difficile la mesure du succès ou de l’échec du projet.
- Impact sur les délais et budgets :
Les projets commencent souvent avec une idée vague des objectifs, ce qui entraîne des ajustements coûteux en cours de route.
Sous couvert de l’idée répandue qu’il ne faut pas attendre que tout soit clair pour initier sous peine de ne jamais initier, on tombe dans un excès dont les effets sont supérieurs en temps de correction au temps qu’on aurait pu dépenser en plus pour clarifier davantage.
Comme dit un autre adage : « il faut se hâter lentement »
- Dérive des exigences (scope creep) :
Un manque de clarté initial favorise l’ajout progressif de nouvelles exigences, compliquant la gestion des ressources et des délais.
C’est lié au point ci-dessus. Le processus d’exploration des besoins dans l’approche de la Quality Function Deployment (Blitz QFD) est en ce sens remarquable de performance.
Comment appliquer la loi de Maier ?
- Analyse approfondie du problème :
- Utiliser l’approche d’exploration de type « Blitz QFD »
- Utiliser des techniques comme le diagramme Ishikawa (ou diagramme des causes et effets) pour identifier les causes profondes.
- Mener des ateliers collaboratifs avec les parties prenantes pour clarifier les besoins et les attentes.
- Définir des objectifs SMART :
Les objectifs doivent être :
- Spécifiques
- Mesurables
- Atteignables
- Pertinents
- Temporellement définis
- Formaliser les exigences :
Documenter les spécifications de manière claire et détaillée pour éviter les malentendus.
- Prototypage rapide :
Créer un prototype ou une maquette pour valider la compréhension du problème par les utilisateurs et les parties prenantes.
- Communication active :
Mettre en place un processus de retour d’information régulier pour affiner la définition du problème et s’assurer que tous les acteurs sont alignés.
Dans synchroboard™, cette étape fait partie du concept de « triple clé ».
C’est un point de contrôle (gate) au cours duquel, on va s’assurer entr’autres que les spécifications sont bien celles prises en compte et que le client n’est pas en train de les remettre en cause ou d’en chercher d’autres.
Exemple pratique :
Dans le développement d’un logiciel de gestion d’inventaire, si le problème est simplement défini comme “Nous avons besoin d’un système pour gérer nos stocks”, cela peut conduire à des solutions inadaptées.
En approfondissant, l’équipe découvre que le vrai problème est “Nous avons besoin de réduire les erreurs humaines dans la saisie manuelle et d’améliorer le suivi des produits en temps réel.”
Cette définition précise guide la création d’une solution adaptée.
Conclusion :
La loi de Maier rappelle que le temps consacré à bien définir un problème est un investissement crucial pour garantir la réussite d’un projet.
Une analyse claire et détaillée des besoins, combinée à une communication efficace, est la clé pour identifier des solutions qui répondent réellement aux attentes des parties prenantes et aux exigences du contexte.
La loi de Peters : Les équipes de projet finissent toujours par produire ce qui est le plus facile à démontrer, et non ce qui est le plus utile.
“Une équipe de projet finit toujours par faire ce qui est le plus facile à démontrer, et non ce qui est le plus important.”
Interprétation :
Cette loi met en évidence une tendance fréquente dans la gestion de projet.
Les équipes priorisent souvent les tâches ou les résultats sont visibles et mesurables, au détriment des aspects plus essentiels mais moins tangibles ou difficiles à quantifier.
Cela peut conduire à des projets où les objectifs stratégiques sont négligés au profit de livrables secondaires ou symboliques.
Pourquoi cette tendance se produit-elle ?
- Pression pour montrer des progrès visibles :
Les parties prenantes ou la direction demandent souvent des preuves concrètes d’avancement, ce qui incite les équipes à se concentrer sur des tâches démontrables.
- Facilité d’exécution :
Les membres de l’équipe préfèrent instinctivement s’attaquer à des tâches simples ou techniquement accessibles, laissant de côté les éléments complexes ou stratégiques.
- Mauvaise priorisation :
Si les priorités ne sont pas clairement définies ou communiquées, les équipes peuvent se concentrer sur des activités qui leur semblent les plus “gratifiantes” à court terme.
- Manque de vision stratégique :
Lorsque les objectifs globaux ne sont pas bien compris, les équipes se rabattent sur ce qui est facile à quantifier.
Implications en gestion de projet :
- Déviation des objectifs stratégiques :
Le projet risque de produire des livrables conformes en apparence mais ne répondant pas aux besoins réels ou critiques.
- Perte de temps et de ressources :
Les efforts sont dirigés vers des tâches secondaires au lieu de se concentrer sur les aspects clés.
- Frustration des parties prenantes :
Lorsque les résultats finaux ne reflètent pas les attentes stratégiques, cela peut entraîner des conflits ou une insatisfaction.
Comment éviter les effets de la Loi de Peters ?
- Définir clairement les priorités :
- ce sont celles du projet et non celles individuelles
- Établir des jalons basés sur des critères d’impact, et non seulement sur la visibilité.
- Encourager une vision à long terme :
- Former les équipes à penser en termes d’objectifs globaux et d’impact.
- Insister sur la valeur stratégique des tâches, même si elles sont moins visibles.
- Surveiller les indicateurs clés :
- Introduire des KPI (Key Performance Indicators) pertinents qui mesurent les résultats importants, pas seulement les étapes intermédiaires.
- Un dash board de projet doit comporter des indicateurs de processus et des indicateurs de résultats afin de respecter un autre adage : « le processus suivi conduit aux résultats qui en découlent ». En soignant son processus, on obtient une meilleure assurance d’atteindre les résultats
- Impliquer les parties prenantes :
- Maintenir une communication régulière pour rappeler les priorités et ajuster les attentes.
- Encourager une culture du feedback :
- Réaliser des revues régulières pour évaluer si les efforts actuels servent réellement les objectifs globaux.
Exemple concret :
Dans un projet de développement logiciel, l’équipe pourrait se concentrer sur la conception d’une interface utilisateur attrayante (facile à montrer lors des présentations) au lieu de se concentrer sur l’optimisation du système backend, qui est plus complexe mais essentiel à la performance globale du produit.
Conclusion :
La Loi de Peters est un rappel précieux pour les chefs de projet : il ne suffit pas de montrer des résultats visibles.
Les efforts doivent être alignés sur ce qui est réellement important pour le succès global du projet.
Une gestion proactive, une priorisation claire et une vision stratégique sont essentielles pour contrer cette tendance naturelle.
La loi de Kidder : Ce qui est mesuré s’améliore. Ce qui est ignoré se détériore.
La Loi de Kidder, attribuée à Tracy Kidder, écrivain et auteur du livre The Soul of a New Machine (1981), énonce :
“Les gens qui n’ont pas le temps de bien faire les choses dès le départ auront toujours le temps de les refaire.”
Interprétation :
La Loi de Kidder souligne l’importance de prendre le temps de bien faire les choses dès le début, notamment dans les projets complexes comme le développement logiciel, la gestion de projet ou l’ingénierie.
Elle met en évidence un phénomène courant : une approche précipitée dans les premières étapes conduit souvent à des erreurs coûteuses, nécessitant des corrections ultérieures, ce qui entraîne des retards et des dépassements de budget.
Implications en gestion de projet :
- Coût des erreurs initiales :
Un travail mal fait dès le départ engendre des problèmes qui deviennent plus coûteux à corriger à mesure que le projet avance.
Par exemple, un problème de conception non détecté peut nécessiter une refonte complète à un stade avancé.
- Perte de temps :
Bien que l’on pense gagner du temps en avançant rapidement, les retours en arrière et les corrections prennent souvent bien plus de temps que si l’on avait pris soin de bien faire dès le départ.
- Impact sur la qualité :
Les produits ou livrables qui subissent de nombreuses corrections risquent d’être de moins bonne qualité, car les ajustements successifs peuvent introduire des incohérences ou des compromis.
Exemple concret :
- Développement logiciel : Si l’on saute l’étape des tests initiaux pour gagner du temps, des bugs non détectés peuvent apparaître en production, nécessitant des corrections d’urgence coûteuses.
- Construction : Une mauvaise estimation des matériaux ou une étape de préparation négligée peut entraîner des retards importants et des surcoûts.
Comment éviter les effets de la Loi de Kidder ?
- Planification rigoureuse :
- Investir du temps dans la planification initiale pour identifier les exigences, les risques et les étapes clés.
- Fixer des étapes intermédiaires pour éviter la précipitation.
- Établir des standards de qualité :
- Définir des critères de qualité clairs pour passer les différentes étapes du projet.
- S’assurer que chaque étape respecte ces standards avant de passer à la suivante.
- Adopter des méthodologies itératives :
- Utiliser des approches comme Agile, qui permettent de développer des incréments successifs tout en intégrant des feedbacks réguliers pour éviter les retours en arrière majeurs.
- Dans l’écosystème synchroboard, ceci est réalisé durant la phase de structuration du projet qui découle du plan de mitigation des risques
- Investir dans les phases critiques :
- Accorder une attention particulière aux premières étapes du projet (recherche, conception, tests initiaux) pour poser des bases solides.
- Former les équipes :
S’assurer que tous les membres de l’équipe comprennent l’importance de bien faire les choses dès le départ et disposent des compétences nécessaires.
Utiliser l’adage “un travail mal fait au début coûte de 7 à 13 fois plus de temps ou de ressources pour le corriger” pour modifier les comportements des personnes
Conclusion :
La Loi de Kidder est un rappel que la précipitation dans les étapes initiales d’un projet peut avoir des conséquences coûteuses.
Prendre le temps de bien planifier, exécuter et valider dès le départ est un investissement qui permet d’économiser des ressources, d’améliorer la qualité et d’assurer le succès global du projet.
Loi de Cohn : Les décisions les plus importantes sont souvent prises sur la base d’informations incomplètes.
La Loi de Cohn, formulée par Mike Cohn, un expert en développement Agile et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, énonce :
“Plus il est difficile de changer un aspect d’un système, plus il est important de bien le définir dès le départ.”
Interprétation de la Loi de Cohn :
La Loi de Cohn met en évidence l’importance de prioriser les aspects critiques d’un projet ou d’un système, en particulier ceux qui seront difficiles, coûteux ou impossibles à modifier par la suite.
Elle souligne que certains choix, comme les fondations d’une architecture logicielle ou les principes fondamentaux d’un produit, nécessitent une attention particulière dès les premières phases de conception.
Implications en gestion de projet :
- Les décisions structurelles ont un impact durable :
Les choix faits au début d’un projet, comme la technologie ou la modularité, influencent fortement la direction future.
Si ces choix sont erronés, les corrections peuvent être coûteuses et complexes.
- Importance de l’analyse initiale :
Les aspects difficiles à changer, comme les dépendances critiques, les normes de qualité ou les objectifs stratégiques, doivent être soigneusement analysés avant le démarrage du projet.
- Flexibilité dans les aspects secondaires :
Les aspects facilement modifiables, comme l’interface utilisateur ou des fonctionnalités non critiques, peuvent être décidés plus tard ou ajustés à moindre coût.
Exemple concret :
- Développement logiciel : Si un système logiciel est conçu sans prendre en compte la scalabilité (capacité à gérer une augmentation de charge), il sera très coûteux de corriger cette erreur plus tard, une fois que le système est en production. La scalabilité étant difficile à modifier, elle doit être bien pensée dès le départ.
- Construction : Dans la construction d’un bâtiment, les fondations doivent être conçues avec précision car elles sont presque impossibles à modifier une fois mises en place, contrairement aux éléments décoratifs ou aux cloisons intérieures.
Comment appliquer la Loi de Cohn ?
- Identifier les éléments critiques :
- Effectuer une analyse approfondie pour repérer les aspects qui seront coûteux ou complexes à modifier (architecture, infrastructure, objectifs stratégiques).
- Prioriser les décisions fondamentales :
- Accorder plus de temps et d’efforts pour définir clairement les aspects clés dès le début.
- Réserver plus de flexibilité aux éléments secondaires ou facilement ajustables.
- Anticiper les changements possibles :
- Utiliser des modèles ou des architectures flexibles (ex. : modularité en développement logiciel ou de conception) pour minimiser les impacts des modifications futures.
- Valider les choix critiques :
- Réaliser des prototypes ou des validations préalables pour s’assurer que les choix initiaux sont alignés avec les objectifs.
Conclusion :
La Loi de Cohn rappelle que toutes les décisions d’un projet n’ont pas la même importance ni les mêmes conséquences. En identifiant et en priorisant les choix fondamentaux, les équipes de projet peuvent réduire les risques, éviter des coûts inutiles et poser des bases solides pour un succès à long terme.
Loi de Weinberg : Une équipe travaillera selon son niveau de tolérance à l’échec.
La Loi de Weinberg, formulée par Gerald Weinberg, un expert en gestion de projet et en développement logiciel, énonce :
“Si les développeurs ont le sentiment que leurs données seront utilisées pour les punir, ils falsifieront les données.”
Interprétation de la Loi :
La Loi de Weinberg met en lumière un problème courant dans les environnements de travail où la performance des équipes ou des individus est mesurée de manière stricte et punitive. Lorsque les employés perçoivent les évaluations ou les indicateurs comme une menace, ils peuvent manipuler les données ou les rapports pour éviter les conséquences négatives, plutôt que d’exprimer honnêtement les difficultés ou les échecs rencontrés.
Implications en gestion de projet :
- Métriques biaisées :
Les rapports et indicateurs de performance deviennent peu fiables, car les employés cherchent à “se protéger” au lieu de refléter la réalité.
- Perte de transparence :
Une culture punitive encourage la dissimulation des problèmes, ce qui retarde leur identification et leur résolution.
- Impact sur la collaboration :
Une atmosphère de méfiance nuit à la communication ouverte entre les membres de l’équipe et peut isoler les individus.
- Échec des projets :
Lorsque les décisions de gestion sont prises sur la base de données inexactes ou falsifiées, les projets risquent de dévier des objectifs ou d’échouer.
Exemple concret :
Dans une équipe de développement produit, si un chef de projet insiste sur des délais stricts en menaçant de sanctions pour les retards, les membres de l’équipe peuvent rapporter des progrès exagérés ou incomplets, cachant les problèmes techniques ou les bugs. Ces problèmes, non détectés à temps, peuvent entraîner des retards plus importants ou un produit de moindre qualité.
Comment éviter les effets de la Loi de Weinberg ?
- Créer les conditions pour le développement de l’intelligence émotionnelle en lieu et place du management répressif :
- Encourager une communication ouverte où les membres de l’équipe se sentent en sécurité pour signaler les problèmes ou les retards sans crainte de représailles.
- Valoriser les apprentissages tirés des erreurs au lieu de les punir. On apprend plus de ses erreurs que de ses réussites
- Utiliser les métriques comme outil d’amélioration :
- Présenter les indicateurs de performance comme un moyen de diagnostiquer et d’améliorer les processus, et non comme une arme pour juger ou sanctionner.
- Encourager la transparence :
- Impliquer les équipes dans la définition des métriques de performance pour s’assurer qu’elles soient pertinentes et comprises par tous.
- Fournir des retours constructifs basés sur les données, sans accusations ni reproches.
- Adopter des pratiques agiles :
- Organiser des rétrospectives régulières pour discuter ouvertement des défis rencontrés et des moyens de s’améliorer.
- Favoriser une approche incrémentale, où les problèmes sont identifiés et corrigés tôt dans le cycle de développement.
- Responsabiliser sans menacer :
- Mettre l’accent sur la responsabilité collective de l’équipe plutôt que sur les performances individuelles.
Conclusion :
La Loi de Weinberg rappelle à chacun qu’une approche punitive dans l’utilisation des données peut compromettre la transparence et la fiabilité des informations cruciales pour le succès d’un projet.
En développant une culture de confiance, d’apprentissage et de collaboration, on encourage des comportements honnêtes et proactifs, essentiels à la réussite des projets.
Ce cheminement est au cœur de l’éco-système synchroboard™ qui favorise le développement de l’intelligence collective comme étant la meilleure forme de performance opérationnelle.
Quelques statistiques surprenantes sur la gestion de projet
Statistique 1 : Utilisation des logiciels de gestion de projet
77 % des entreprises possèdent un logiciel de gestion de projet, mais seulement 23 % l’utilisent quotidiennement.
Pourquoi 54 % des entreprises ne les utilisent-elles pas au quotidien ? La gestion de projet est omniprésente dans la plupart des secteurs.
Cette situation pourrait s’expliquer par des fonctionnalités mal adaptées ou par un manque de clarté sur les bénéfices réels des logiciels.
Sans utilité perçue, ces outils risquent de devenir obsolètes.
Statistique 2 : Taux de réussite des projets
- 31 % des projets respectent délais, budget et exigences initiales.
- 52 % sont terminés avec des dépassements ou des ajustements.
- 19 % sont annulés avant leur achèvement.
Ces chiffres mettent en lumière des problèmes systémiques dans la gestion de projet, notamment des estimations irréalistes, des objectifs mal définis, ou des changements mal maîtrisés.
Ils invitent à repenser les pratiques pour améliorer les résultats : meilleure planification, communication efficace et adoption d’outils adaptés aux besoins réels.
- Une opportunité pour repenser la gestion de projet:
Les 31 % de projets réussis prouvent qu’il est possible d’atteindre les objectifs, même dans des environnements complexes.
Cependant, le fait que près de 70 % des projets rencontrent des problèmes ou des échecs partiels souligne l’urgence d’améliorer le contenu et la maturité des processus de gestion de projet.
Cette amélioration passe par une approche structurée pour traiter les causes systémiques des échecs, un défi que l’écosystème Synchroboard™ s’efforce de relever.
Le chiffre alarmant de 19 % de projets avortés pointe spécifiquement vers un besoin de renforcer le processus d’identification des besoins clients et d’améliorer la construction de la proposition de valeur.
Dans ce contexte, l’outil Blitz QFD, inclus dans l’écosystème Synchroboard™, se révèle particulièrement puissant pour structurer et explorer les besoins de manière approfondie, permettant de mieux aligner les projets sur les attentes réelles des parties prenantes.
- Importance de la communication et des parties prenantes :
De nombreux dépassements de délais ou annulations de projets proviennent d’une gestion insuffisante des attentes ou de malentendus entre les parties prenantes.
Une meilleure clarté et une compréhension partagée peuvent apporter des améliorations significatives, notamment :
- Anticiper les évolutions des exigences :
Une gestion rigoureuse des points de contrôle et de certification, comme les « triples clés » intégrées dans l’écosystème Synchroboard™, garantit que les spécifications et les attentes des clients sont validées tout au long du projet.
Cela permet d’intégrer les évolutions sans perturber le déroulement global.
- Réduire les frustrations liées aux retards et ajustements :
La tenue de points réguliers, appelés « synchro-points » dans Synchroboard™ (équivalent des scrums dans la démarche Agile), permet de maintenir l’alignement entre les équipes et les parties prenantes.
Ces réunions favorisent une communication fluide et une adaptation proactive, évitant ainsi les blocages et frustrations.
Grâce à ces outils, Synchroboard™ offre une structure qui renforce la collaboration et l’efficacité, même dans des contextes de projets complexes ou évolutifs.
- Focus sur la réduction des dépassements (52 %) :
Le nombre élevé de projets qui dépassent les budgets ou les délais souligne l’urgence d’améliorer certains aspects fondamentaux de la gestion de projet :
- Améliorer l’estimation :
Une meilleure précision dans les prévisions de ressources, de temps et de budget est essentielle. Pour cela :
- Utiliser des simulations basées sur des données réelles ou des scénarios prédéfinis.
- Exploiter des données historiques pour identifier les écarts récurrents et ajuster les modèles d’estimation.
- Renforcer le contrôle en cours de projet :
Mettre en place des outils de gestion efficaces pour suivre les progrès en temps réel, comme :
- Des tableaux de bord et outils collaboratifs pour visualiser l’état d’avancement.
- Des mécanismes permettant d’ajuster rapidement les tactiques face aux imprévus.
- Adopter un nouveau rapport au temps :
Le temps ne doit pas être considéré comme un budget à consommer intégralement (conformément à la loi de Parkinson). À la place :
- Gérer le temps comme un compte en banque, où chaque minute gagnée peut être réinvestie ailleurs.
- Utiliser des outils comme les burn-down charts pour visualiser et optimiser l’utilisation du temps restant, plutôt que de focaliser sur les tâches accomplies.
En appliquant ces approches, les chefs de projet peuvent non seulement réduire les dépassements, mais aussi améliorer l’efficacité et la satisfaction des parties prenantes.
- L’intégration de la qualité des livrables dans la gestion de projet :
- Les 5 Moyens de l’Auto-Qualité
Les 5 moyens de l’auto-qualité sont des outils fondamentaux pour garantir qu’aucun défaut n’est créé ni n’est transmis aux étapes suivantes du projet.
Ces moyens font partie intégrante des informations incluses dans les kanbans utilisés par Synchroboard™.
Voici une présentation détaillée du principal mécanisme, le quality gate/triple clé.
- Quality Gate/Triple Clé
Le quality gate ou triple clé est un point de passage obligatoire destiné à certifier le travail réalisé avant de progresser à la phase suivante. Ce processus garantit que chaque tâche est conforme et qu’aucune exigence cruciale n’a été négligée.
- Exemple de Triple Clé :
- Pour la phase de livraison des plans, nomenclatures, calculs et informations techniques, la triple clé inclut :
- Une vérification complète des livrables techniques pour assurer leur conformité.
- Une certification par le chef de projet que les spécifications et exigences du client sont stables. Cela signifie notamment que le client n’est pas en train de réfléchir à de nouvelles exigences ou modifications, ce qui pourrait compromettre le passage de phase.
- Une validation finale impliquant toutes les parties prenantes concernées.
- Exemple de Triple Clé :
- L’objectif de l’Auto-Qualité :
- Éviter la transmission de défauts ou d’informations incomplètes vers les tâches suivantes.
- Maintenir un niveau de qualité élevé à chaque étape du projet.
- Renforcer la confiance dans les livrables et dans la synchronisation des équipes.
- L’objectif de l’Auto-Qualité :
En intégrant ces mécanismes à l’écosystème Synchroboard™, les équipes disposent d’un cadre robuste pour certifier leur travail et garantir un déroulement fluide et sans erreurs dans l’ensemble du cycle de vie du projet.
- Les impacts financiers et organisationnels :
Ces statistiques révèlent un impact financier et stratégique majeur pour les entreprises :
- Pertes de ressources et opportunités manquées :
Les dépassements de coûts et les annulations de projets représentent :
- Des ressources humaines et financières gaspillées.
- Des opportunités commerciales manquées, pouvant affecter la croissance et la compétitivité de l’entreprise.
- Une gestion optimisée avec Synchroboard™ :
En adoptant une approche structurée comme celle proposée par Synchroboard™, il est possible :
- De réduire significativement les dépassements de coûts et de délais grâce à une meilleure synchronisation des tâches et une gestion proactive des risques.
- D’améliorer la confiance des parties prenantes, en assurant une communication claire et des résultats prévisibles.
Un renforcement de la compétitivité :
Grâce à une gestion améliorée, Synchroboard™ permet non seulement d’optimiser les ressources, mais aussi de consolider la crédibilité et la réactivité de l’entreprise.
Ces gains se traduisent directement par une meilleure compétitivité sur le marché et une capacité accrue à répondre aux exigences des clients.
Pourquoi attribue-t-on systématiquement plus de temps que nécessaire aux tâches ?
Abstract
L’attribution de temps supplémentaire pour gérer les imprévus, basée sur la loi de Parkinson, s’avère inefficace : elle ne résout pas les causes profondes, génère du gaspillage, allonge les délais et compromet les opportunités. Les imprévus ne sont pas toujours imprévisibles, mais souvent le résultat d’une détection ou d’une gestion tardive. Les erreurs personnelles, les modifications en cours, le manque de compétences et les lacunes d’information figurent parmi les causes les plus fréquentes.
Ajouter du temps ne garantit pas le succès des projets. Une approche efficace nécessite une gestion proactive, incluant l’identification précoce des risques, une réaction rapide et la collaboration de l’équipe. Cela permet d’optimiser les processus, de réduire les écarts et d’améliorer la résilience, transformant les incertitudes en opportunités pour atteindre les objectifs.
Pourquoi attribue-t-on systématiquement plus de temps que nécessaire aux tâches ? 🤔
« Une tâche est toujours répartie pour occuper tout le temps disponible. »
C’est l’enseignement de la loi de Parkinson dans la gestion de projet.
Cette loi est facile à comprendre, tout comme ses conséquences.
Mais pourquoi donne-t-on systématiquement plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche ? Et est-ce que cela augmente vraiment les chances de respecter les délais ?
Le surplus de temps attribué agit comme une provision ou une caution pour se protéger de toutes sortes d’inconnus.
Il vise à limiter :
- La peur 😨 et le stress 😟 générés par l’inconnu,
- L’impact négatif 👀 du regard des autres (collègues, supérieurs) sur notre travail.
Le raisonnement est donc simple :
Plus il y a d’éléments inconnus, plus il faut s’en prémunir. 🔍
Les éléments inconnus sont-ils tous imprévisibles ? 🤔
Les éléments imprévisibles sont ceux sur lesquels nous ne pouvons pas agir 🔒.
Tous les autres sont potentiellement prévisibles 🔍, mais apparaissent parce que nous n’avons pas su les détecter à temps ⏱️. Dès lors, on les appelle des imprévus 🔄
Quels sont les imprévus fréquents ? 🤔
La liste est vaste. Dans le cadre de la gestion de projet, les imprévus les plus significatifs et récurrents incluent :
- Devoir consommer plus de temps 🕒 en raison de :
- Erreurs personnelles ❌,
- Indications erronées 📋,
- Modifications en cours de projet 🔄,
- Manque de compétences 🧠,
- Affectation de tâches supplémentaires non prévues au départ ➕,
- Attentes d’informations 📩.
- Faire face à des lacunes d’informations ❓ sur la tâche à accomplir, notamment concernant :
- Sa durée effective ⏱️ (temps de cycle nominal),
- L’étendue du temps nécessaire 🗓️ (lead time), soit le temps global requis pour sa réalisation.
Cette approche augmente-t-elle la probabilité de terminer le projet à temps ? 🤔
Bien que courante en gestion de projet, les faits sont clairs :
- 2 projets sur 3 n’atteignent pas tous leurs objectifs 🎯,
- 1 projet sur 2 n’en atteint qu’une partie 📉.
- Si cette approche fonctionnait réellement, nous n’aurions pas besoin d’en débattre.
On peut donc conclure à minima qu’ elle ne garantit pas, à elle seule, la réussite des projets 🛑.
En réalité, elle n’en sera jamais capable 🚫
Pourquoi cette approche ne permettra pas de respecter les délais impartis ? 🤔
Ajouter du temps supplémentaire vise à compenser les imprévus, mais ne traite pas leurs causes profondes. On se contente de limiter leurs conséquences, laissant le projet exposé à leur impact perturbateur.
Conséquences directes de cette approche :
- Un effet en cascade 🔄 : si les imprévus consomment plus que le temps alloué, les tâches suivantes sont retardées.
- Un allongement global 🕒 : le projet nécessite plus de temps pour être réalisé.
Une question clé : que devient le temps excédentaire si une tâche se termine avant la date prévue ?
La loi de Parkinson répond clairement : Ce temps “excédentaire” n’existe pas réellement, car il est systématiquement consommé par un étalement des tâches jusqu’à occuper tout le temps disponible, même sans imprévus.
Conclusion :
Cette approche crée une illusion de sécurité mais :
- Ne permet pas d’anticiper efficacement les imprévus,
- Allonge inutilement les délais,
- Échoue à optimiser le temps disponible.
Les conséquences directes sont :
- Un gaspillage de temps 🕒 alloué inutilement à des tâches qui auraient pu être terminées plus tôt.
- Une opportunité manquée 🚀 de démarrer les activités suivantes plus rapidement.
- Une impossibilité de compenser les retards ⏳ par des avancées réalisées ailleurs.
Il n’y a plus de doute : « Ajouter systématiquement du temps ne garantit pas l’atteinte des objectifs d’un projet, notamment le respect des délais. » ❌
Une alternative se dessine : « Changer le point de vue avec lequel on conçoit et on affronte l’inconnu » pourrait être la clé pour mieux gérer les imprévus et renforcer les chances de succès.
Les 10 convictions fondamentales à acquérir pour maximiser la réussite en gestion de projet 🚀
- « La peur n’écarte pas le danger. » ⚠️
- Affronter le danger permet de le maîtriser, plutôt que de chercher à l’éviter.
- « Un danger est un risque non documenté. » 📋
- Documenter un risque permet de le classer parmi les éléments connus.
- Des actions concrètes peuvent alors être établies pour le maîtriser, le rendant quantifiable et gérable.
- « Tous les éléments inconnus ne sont pas imprévisibles. » 🔍
- Les imprévus relèvent de notre cercle d’influence et d’action.
- Les imprévisibles, eux, appartiennent au cercle des préoccupations et peuvent distraire ou paralyser nos capacités.
- « Les résultats découlent de la qualité des processus qui les génèrent. » 🔧
- Identifier les zones de risque dès le départ et planifier leur mitigation.
- Certifier les travaux pour limiter les surprises.
- Réduire les temps morts entre les tâches.
- Éviter les déviations et corriger rapidement les causes profondes.
- « Commence quand tu veux, mais termine avant la date prévue. » 🕒
- Cela encourage la liberté d’entreprendre tout en renforçant la responsabilité des engagements.
- « Si un retard est inévitable, informe rapidement les personnes concernées. » 📣
- La solidarité d’équipe exige une communication rapide et transparente.
- Éviter rancunes ou règlements de compte en mettant le projet au centre des priorités.
- « Le temps appartient au projet, pas aux individus. » ⏱️
- Considérer le temps comme une ressource à optimiser, et non comme un budget à consommer.
- « La nécessité d’utiliser 100 % du temps alloué est statistiquement improbable. » 📊
- L’objectif doit être d’accomplir une tâche en consommant moins de temps que prévu.
- « La performance globale n’est jamais atteinte par la somme des performances individuelles. » 🤝
- L’intelligence collective est le levier principal de la performance opérationnelle.
- Une approche managériale claire renforce l’engagement de l’équipe pour atteindre les objectifs communs.
- « Ajouter un temps supplémentaire ne favorise pas à lui seul la réussite du projet. » 🚫
- Il a été démontré que cette pratique est souvent contre-productive.
En résumé, pour maximiser la réussite d’un projet tout en préservant le bien-être des personnes impliquées, il est essentiel de :
- Identifier précisément les imprévus 🔍 pour mieux les affronter dès leur apparition, afin d’éviter des comportements inappropriés ou des réactions disproportionnées.
- Réagir rapidement ⚡ face aux imprévus résiduels et aux déviations, pour limiter leur impact avant qu’ils ne s’amplifient et n’affectent gravement le projet.
- Encourager l’interactivité et la collaboration 🤝, afin de développer une intelligence collective capable de répondre efficacement aux défis.
- Apprendre des échecs passés 📚 en les intégrant dans le processus de gestion, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et renforcer la résilience du projet.
Pourquoi les applications de gestion de projet échouent-elles souvent à répondre aux attentes ?
Les applications de gestion de projet, bien qu’elles soient conçues pour faciliter la coordination, améliorer la productivité et centraliser les informations, révèlent parfois leurs limites en pratique. Environ 60 % des projets échouent à atteindre leurs objectifs initiaux, même avec des outils dédiés. Ce constat souligne un paradoxe : malgré les moyens déployés, les résultats attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Cela va à l’encontre du principe de “Less Make More”, où la simplicité et l’efficacité devraient primer.
Problème de complexité :
Bien que ces logiciels offrent une large gamme de fonctionnalités, leur complexité devient un frein majeur pour les utilisateurs. Selon un sondage récent, 40 % des utilisateurs admettent ne pas exploiter pleinement ces outils, faute de formation adaptée ou par manque d’intérêt. Cela empêche ces solutions d’atteindre leur plein potentiel et limite leur impact sur la réussite des projets.
Conclusion :
Pour maximiser l’efficacité des logiciels de gestion de projet, il est crucial de simplifier leur utilisation, de proposer une formation adéquate et de s’assurer que leur adoption repose sur une réelle compréhension des besoins des utilisateurs.
Tool based-Project management: Les limites des logiciels de gestion de projet et la nécessité d’une Intelligence Collective
Les logiciels de gestion de projet sont souvent perçus comme des solutions capables de compenser les problèmes de communication et d’interaction au sein des équipes. On tend parfois à leur attribuer des capacités quasi “intelligentes”, comme si une intelligence artificielle pouvait résoudre automatiquement ces dysfonctionnements.
Cependant, une évaluation menée en 2023 révèle que plus de 50 % des utilisateurs estiment que ces outils ne s’adaptent pas aux spécificités de leurs workflows.
De nombreuses entreprises utilisent simultanément plusieurs applications, ce qui disperse l’information au lieu de la centraliser.
Cette fragmentation nuit à l’efficacité globale et crée des silos de données.
La clé : L’Intelligence Collective
Pour maximiser l’efficacité des outils de gestion de projet, il est essentiel de dépasser la simple gestion des tâches pour instaurer une véritable Intelligence Collective.
Cette approche repose sur :
- Synchronisation optimale :
- Aligner les équipes, les tâches et les objectifs pour garantir que toutes les parties avancent dans la même direction.
- Assurer une coordination fluide entre les différents acteurs et éviter les efforts dispersés ou les redondances.
- Centralisation des informations :
- Réunir toutes les données pertinentes dans un espace unique, accessible à tous les membres du projet.
- Éliminer les silos organisationnels et les doublons pour offrir une vision claire et partagée de l’avancement du projet.
- Adaptabilité des outils :
- Intégrer des solutions flexibles, capables de s’adapter aux besoins spécifiques et aux processus internes de chaque entreprise.
- Permettre une personnalisation suffisante pour refléter les réalités opérationnelles et maximiser l’efficacité des équipes.
Synchroboard™ vise précisément cet objectif en plaçant l’Intelligence Collective au cœur de son écosystème. En créant les conditions nécessaires à une collaboration fluide et à une communication enrichie, il permet d’atteindre le plus haut niveau de performance organisationnelle dans la gestion de projet.
L’Intelligence Collective n’est pas seulement une finalité, c’est un moteur pour transformer les défis organisationnels en opportunités d’excellence.
Les logiciels ont-ils permis d’améliorer significativement ces causes systémiques des échecs de la gestion de projet
D’après le Standish Group, dans son célèbre rapport CHAOS, le taux de réussite des projets demeure stable, autour de 29 %, toutes méthodologies confondues, malgré un taux d’adoption des outils de gestion de projet atteignant 77 % dans les entreprises.
Les limites des outils existants :
Bien que l’utilisation de ces outils ait augmenté et qu’ils offrent une panoplie de fonctionnalités pour améliorer la communication, la planification et le suivi, les taux de réussite des projets n’ont pas connu de progression notable. Ce constat suggère que certains concepts ou comportements fondamentaux doivent être réexaminés et adaptés aux réalités organisationnelles.
Les causes des échecs :
Les échecs en gestion de projet sont répartis de manière équitable :
- 50 % liés à la gestion de projet (ex. : planification, suivi, maîtrise des risques).
- 50 % liés à l’organisation et au management de l’entreprise (ex. : culture d’entreprise, leadership, alignement stratégique).
Cette répartition explique pourquoi les logiciels de gestion de projet, aussi performants soient-ils, n’ont pas suffi à générer des améliorations significatives dans les taux de réussite. Les outils ne peuvent compenser des dysfonctionnements organisationnels ou des problèmes structurels dans la gestion du travail en équipe.
Conclusion :
Pour réellement améliorer les résultats, il est crucial d’associer l’utilisation des logiciels à une évolution des pratiques managériales et organisationnelles, en intégrant des principes comme l’intelligence collective, une meilleure définition des objectifs, et une communication inter-équipes renforcée.
Les logiciels ont-ils permis d'améliorer significativement ces causes systémiques des échecs de la gestion de projet?
D’après le Standish Group, dans son célèbre rapport CHAOS, le taux de réussite des projets demeure stable, autour de 29 %, toutes méthodologies confondues, malgré un taux d’adoption des outils de gestion de projet atteignant 77 % dans les entreprises.
Les limites des outils existants :
Bien que l’utilisation de ces outils ait augmenté et qu’ils offrent une panoplie de fonctionnalités pour améliorer la communication, la planification et le suivi, les taux de réussite des projets n’ont pas connu de progression notable. Ce constat suggère que certains concepts ou comportements fondamentaux doivent être réexaminés et adaptés aux réalités organisationnelles.
Les causes des échecs :
Les échecs en gestion de projet sont répartis de manière équitable :
• 50 % liés à la gestion de projet (ex. : planification, suivi, maîtrise des risques).
• 50 % liés à l’organisation et au management de l’entreprise (ex. : culture d’entreprise, leadership, alignement stratégique).
Cette répartition explique pourquoi les logiciels de gestion de projet, aussi performants soient-ils, n’ont pas suffi à générer des améliorations significatives dans les taux de réussite. Les outils ne peuvent compenser des dysfonctionnements organisationnels ou des problèmes structurels dans la gestion du travail en équipe.
Conclusion :
Pour réellement améliorer les résultats, il est crucial d’associer l’utilisation des logiciels à une évolution des pratiques managériales et organisationnelles, en intégrant des principes comme l’intelligence collective, une meilleure définition des objectifs, et une communication inter-équipes renforcée.
Classification des causes systémiques de défaillance de la gestion de projet
| Causes strictement liées à la gestion de projet | Causes strictement liées à l’organisation et au management de l’entreprise |
Taux excessif >35% | Modification des objectifs du projet : 37% | Modification des priorités au sein de l’organisation : 39% |
Taux très élevé >20% et <30% | Communication inadéquate ou insuffisante : 29% Opportunités et risques non définis : 29% Support sponsor insufficient: 26% Estimation imprécise du temps d’activité : 25% | Vision et objectifs inadaptés : 29% Mauvaise gestion du changement : 28% Dépendance des ressources : 26% Project manager inexpérimenté : 22% |
Taux élevé <20% | Procrastination des membres de l’équipe : 13% | Previsione inadeguata delle risorse: 18% Dipendenza dall’attività: 12% |
Convictions sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour concevoir Synchro board
Convictions | Impact sur la gestion de projet | Impact sur l’organisation et au management de l’entreprise |
Un projet ne démarre que parce qu’il a été évalué suffisamment contributeur aux objectifs stratégiques de l’entreprise | Évite au projet d’être annulé ou reporté | Oblige l’entreprise à évaluer la contribution de chaque projet dans le portefeuille |
Un projet ne démarre qu’après avoir exploré les besoins du marché | Permet d’avoir plus de certitudes sur les attendus Permet de découvrir des besoins latents non exprimés | Oblige l’entreprise à mettre en place un véritable processus d’exploration de son marché |
On ne peut faire un gantt qu’après avoir établi un plan de mitigation des risques qui intègre les dimensions QCDP | Évite l’ajout de tâches une fois le projet lancé | Oblige l’entreprise à minimiser les risques économiques et d’image de la société envers son marché |
On ne gère pas un projet complexe avec des outils complexes. On scinde la complexité pour la gérer plus facilement avec des outils simples | L’équipe est davantage opérationnelle. Elle reste focalisée sur l’essentiel. Son attention ne se disperse pas. C’est l’outil qui s’adapte aux personnes et non le contraire | Remettre en cause les choix faits pour les outils Former les personnes à leur utilisation |
Seules les tâches qui concernent au moins deux parties doivent être régulièrement suivies | Le chef de projet et les membres sont davantage focalisés sur le chemin critique et les tâches délicates. | Oblige les manager de fonction à gérer localement les tâches spécifiques au métier.
|
Le temps qui reste pour compléter une tâche compte plus que le temps consommé et la progression de la tâche | Focalise l’attention sur le temps qui reste à disposition Evite les considérations sur le pourcentage accompli (loi 90-90) | Former les personnes à ce changement profond de paradigme |
La durée affectée à une tâche n’est pas un budget pour lequel on a le droit de tout dépenser | On ne dépense que ce qui est nécessaire pour réaliser la tâche et la certifiée conforme. | Former les personnes à ce changement profond de paradigme En tenir compte dans l’élaboration d’un gantt standardisé |
Il est statistiquement improbable qu’une activité consomme 100% du temps alloué. Soit on en consomme plus soit on en consomme moins | Dans les deux cas, l’équipe analyse les conséquences positives ou négatives qui en découlent pour replaifier le projet en anticipant la réalisation de tâches successives ou minimisant l’impact du retard accumulé | Former les personnes à ce changement profond de paradigme Modifier la procédure pour l’élaboration du gantt de projet |
Une tâche est considérée terminée si elle a été certifiée conforme | Oblige les équipes à déclarer comment elles vont certifier la tâche. Cela peut prendre un temps initialement non comptabilisé si l’on n’a pas réfléchi à l’impact que peut avoir la non-conformité sur les objectifs du projet | Former les équipes aux méthodes issues de la gestion de la qualité en lean production : 5 moyens de l’auto-qualité Matrice auto-qualité Concept « ne pas accepter, ne pas créer, ne pas transmettre » une non-conformité |
Un projet complexe doit être découpé de telle sorte qu’une certification fonctionnelle puisse être établie sans attendre la phase finale avec le produit complètement défini pour intercepter au plus tôt les non conformités | Evite une des causes principales d’insuccès à savoir la reprise d’erreurs découvertes à la dernière minute Oblige les équipes a intégrer dans le gantt, des activités dédiées à la certification fonctionnelle | Intégrer les délais et les coûts de certification dans les gantt standard (prototypages, laboratoires extérieurs,…) |
C’est seulement lorsque toutes les tâches de toutes les parties prenantes sont achevées et certifiées conforme qu’il est possible de passer à la phase (gate) successive | Focalise davantage l’attention sur la qualité des livrables pour réduire les découvertes d’erreurs plus tard dans le projet
| Intégrer cette nécessité dans le standard de gestion de projet. Avec synchroboard, cette activité est appelée « triple clé » |
Bien faire du premier coup est la meilleure façon de gérer son temps et d’optimiser les couts | Modifie le comportement des personnes Casse le paradigme qui justifie qu’on n’a pas le temps de bien faire car on a plein de choses à corriger (loi de Hofstadter) | Former les personnes à ce changement profond de paradigme
|
Quelle que soit la nature des problèmes, ils doivent être affrontés pour être solutionnés et non contournés | La résolution de problèmes relationnels crée un climat de confiance propice à l’émergence de l’intelligence collective
| Intégrer la notion d’intelligence collective dans les équipes Former les équipes à l’intelligence émotionnelle La résolution de problèmes organisationnels améliore le rendement des équipes La résolution de problèmes technique est facilitée par la mise en place d’un processus d’arbitrage |
On ne structure pas un projet avec l’idée de sacrifier un des composants du triangle d’or (qualité-couts et délais) | Elève le niveau d’exigence de l’équipe Elève la performance opérationnelle | Modifier le paradigme en s’appuyant sur la loi de Weinberg |
Le logiciel ne doit pas faire du « pilotage automatique ». Ce sont toujours les personnes qui gardent la main et la compréhension de ce qui se passe | D’une manière contre intuitive, ce concept facilite la compréhension du projet c’est-à-dire le point où individuellement on est arrivé en relation avec les points où les autres membres de l’équipe sont arrivés | Revoir la façon dont les logiciels de gestion de projet favorise plus ou moins cette possibilité |
L’intelligence collective est la forme la plus élevée de performance opérationnelle. | Meilleure efficience dans le projet Relations apaisées Moins de frustrations et plus de compréhension réciproque | Insérer cette conception dans les attributs du chef de projet et des représentants des parties prenantes Former les personnes à l’intelligence émotionnelle une des 3 composantes de l’intelligence collective |
Imprévus, Imprévisibles, Inéluctables et autres Inconnus: Gagner contre l'un des plus grands perturbateurs de la gestion de projet
Abstract:
Dans la gestion de projet, l’imprévu est souvent perçu comme un obstacle inattendu qui perturbe les plans les mieux préparés. Pourtant, l’imprévu ne doit pas être confondu avec l’imprévisible. Tandis que l’imprévisible échappe à toute anticipation, l’imprévu trouve ses racines dans l’inconnu : des hypothèses non vérifiées, des informations manquantes ou des processus mal maîtrisés. Cet article explore comment les imprévus naissent des zones d’incertitude et propose des stratégies concrètes pour les anticiper et en réduire l’impact. Parmi ces approches, la rigueur dans la gestion des détails, la certification des étapes et une réaction rapide face aux écarts permettent de transformer l’imprévu en une opportunité d’apprentissage. En adoptant une démarche proactive et déterministe, les équipes peuvent réduire l’inconnu et renforcer leur capacité à atteindre leurs objectifs, même face à l’imprévu.
C’est dans l’inconnu que se cache l’imprévu 🚀🔍
En gestion de projet, l’imprévu est souvent vu comme un perturbateur inattendu 😬, l’une des causes fréquentes d’échec dans l’atteinte de nos objectifs.
Combien de fois entendons-nous : « Sans cet imprévu, tout aurait fonctionné… » ?
Mais posons-nous la vraie question : était-ce un imprévu ou un imprévisible ? 🤔
Par nature, l’imprévisible échappe à toute anticipation. En revanche, l’imprévu résulte souvent d’un manque de rigueur : une hypothèse non vérifiée, une analyse insuffisante ou un processus mal exécuté.
L’imprévu naît de l’inconnu 🌫️, cet espace vaste et complexe qui regroupe tout ce que nous ignorons ou négligeons.
Une information manquante, un travail non certifié, ou une mauvaise synchronisation entre équipes constituent autant de zones d’incertitude 🌪️ qui se transforment rapidement en imprévus perturbateurs.
Plus un projet est complexe, plus les inconnus sont nombreux, et plus les imprévus surgissent.
Pour limiter ces situations, il est essentiel de
refuser le fatalisme 🚫. L’inconnu ne doit jamais être une justification à l’échec. Rien n’est inéluctable : chaque imprévu est une opportunité d’analyse et d’amélioration.
Adopter une approche déterministe. Nous sommes convaincus que les résultats découlent des processus mis en place 🔄.
Ainsi, en améliorant notre capacité à gérer les imprévus, nous rendons les projets plus prévisibles et leurs résultats plus fiables.
Pour cela, il faut maîtriser les détails 🧐 :
identifier les zones à risque,
certifier les travaux ✔️, et
synchroniser les équipes et tâches 🤝.
Adopter une gestion réactive face aux écarts 🚨 :
reconnaissons-les,
analysons leurs causes profondes et
corrigeons-les pour éviter qu’ils ne se reproduisent.
Chaque imprévu est une leçon pour réduire l’inconnu dans les projets futurs 📘.
Si nous apprenons à explorer l’inconnu avec rigueur et à traiter les imprévus comme des opportunités, nous renforcerons notre résilience et nos chances de succès.
Et si l’imprévu devenait notre allié ? 💪🚀
⚠️ Nessun post disponibile.
PARTNERSHIP

Partager des points de vue sur des défis communs stimule la créativité et conduit souvent à des solutions simples et efficaces.
Face aux difficultés liées à la survie et à l’évolution, les entreprises, souvent sous pression par manque de temps, ont tendance à opter pour des solutions standardisées, dictées par l’habitude plutôt que par une analyse réellement adaptée à leurs besoins.
Nous croyons que les partenaires jouent un rôle essentiel pour inverser cette tendance. Leur contribution dépasse la simple promotion de nos solutions : ils enrichissent notre approche en partageant leurs besoins et leurs suggestions.
Cette collaboration vise à créer une valeur réciproque, bénéfique pour Synchroboard, les partenaires et les clients. C’est pourquoi nous avons développé divers programmes adaptés aux différents niveaux de compétence technique et d’engagement des partenaires. Ces programmes vont de la mise en relation avec des clients potentiels qualifiés jusqu’à la gestion complète de l’implémentation.
Nous proposons également un programme de formation avec certification, conçu pour les partenaires souhaitant renforcer leurs compétences et maximiser leur impact.
Profils de Partnership

Referral
- Réalise la promotion
- Etablit le contact avec le prospect
- Ne participe pas au processus de vente

Reseller
- Réalise la promotion et la vente avec notre support
- Est supporté sur demande, au cas par cas

Integrator
- Réalise la promotion, la vente et la mise en place en autonomie
- Offre uniquement des services standard.

Business Developper
- Réalise la prestation et le support auprès de clients identifiés.
- Participe au développement de nouvelles applications
Entreprises et des professionnels qui reconnaissent les avantages de nos solutions pour leurs clients ou pour d’autres entreprises de leur réseau.
Lorsqu’ils identifient une opportunité d’utiliser nos applications, ils la signalent à l’équipe Synchroboard™, qui prend en charge les étapes suivantes du processus de vente.
Entreprises et professionnels spécialisés dans la gestion stratégique et de la performance (Hoshin Kanri, QFD, développement produit, lean manufacturing, …) et dans tout secteur nécessitant la gestion de projets complexes.
Ces partenaires cherchent à enrichir leur portefeuille de produits et services avec des solutions à forte valeur ajoutée.
Les reseller partner peuvent se présenter à leurs clients avec une image cohérente, renforçant ainsi leur offre.
Ils gèrent de manière autonome la vente de Synchroboard à leurs clients, avec le soutien éventuel de l’équipe Synchroboard pendant la phase de prévente.
Le support technique et la prestation de services (pour lesquels le partenaire n’est pas encore formé) sont assurés en toute sécurité par l’équipe Synchroboard.
Entreprises et professionnels ayant des compétences dans la gestion de la stratégie et de la performance (Hoshin Kanri, QFD, développement produit, lean manufacturing, …) et dans tout secteur nécessitant la gestion de projets complexes.
Ces partenaires cherchent à enrichir leur portefeuille de produits et services avec des solutions à forte valeur ajoutée.
Ils disposent d’une équipe hautement compétente pour gérer de manière autonome leurs clients, tant sur le plan technique que commercial.
Ils assurent un support technique direct à leurs clients.
Ils font appel à l’équipe Synchroboard uniquement pour la prestation de services avancés.
Entreprises et professionnels dotés de compétences en gestion de la stratégie et de la performance (Hoshin Kanri, QFD, développement produit, lean manufacturing, …) et dans tout secteur nécessitant la gestion de projets complexes.
Ils ont démontré leur capacité à gérer de manière autonome même les projets les plus exigeants et à fournir des services avancés.
Ils reçoivent des leads qualifiés dans leur zone pour développer davantage leur activité.
Ils collaborent avec l’équipe Synchroboard pour planifier de nouveaux développements techniques et stratégiques.
FAQ
Sécurité des données
Quel est le niveau de sécurité du cloud sélectionné ?
SB : Nous avons choisi Google Cloud Platform (GCP) pour sa grande sécurité, tant en matière de cybersécurité que de protection des données. GCP garantit les normes européennes les plus élevées en termes de sécurité :
•ISO27001 pour la protection et la sécurité des données,
•ISO27017 pour la sécurité des environnements cloud,
•ISO27018 pour la protection des données personnelles dans le cloud.
Interfaçage avec des applications existantes
Quels sont les données à importer dans Synchroboard™ ?
SB : Les éléments à intégrer dans l’application sont ceux habituellement utilisés pour définir un diagramme de Gantt :
•Date de début du projet
•Jalons
•Tâches
•Entité responsable
•Personne assignée
•Dates de début et de fin de chaque tâche
•Durée
•Couleurs prédéfinies
Ensuite, Synchroboard™ traite ces données pour générer des éléments visuels utiles à l’écosystème dans lequel il évolue.
Les données traitées dans Synchroboard™ peuvent-elles être exportées vers l’application d’origine ?
L’application initiale sert uniquement à l’élaboration du diagramme de Gantt du projet. Par la suite, il n’y a plus aucune valeur ajoutée à revenir à l’application d’origine. Par conséquent, cette fonctionnalité n’est pas prévue.
Sécurité code source
Que se passe-t-il si l’entreprise propriétaire et/ou l’éditeur de logiciels font faillite ?
SB : Le code source est sécurisé sur GitHub et reste accessible à tous les clients enregistrés en cas de faillite de la structure externe.
GitHub est une plateforme collaborative de développement basée sur Git, un système de contrôle de version distribué. Elle permet aux développeurs et aux équipes de gérer, collaborer et partager le code source pour des projets logiciels. GitHub est l’une des plateformes les plus populaires pour les projets open-source et commerciaux, offrant des outils puissants pour le contrôle des versions, la gestion de projets et la collaboration.
Assistance technique
Comment est organisé le support technique ?
SB : Le support technique couvre toutes les demandes de résolution rapide, tous les bugs système et les éventuelles erreurs non imputables au client.
Pour les clients souhaitant un service d’assistance maximal, nous proposons également un support technique par téléphone moyennant un abonnement supplémentaire.
L’abonnement garantit une intervention sous 24 heures après l’ouverture du ticket.
Quel est le coût de la mise à jour de l’application ?
La mise à jour est incluse dans le prix de la licence, elle ne génère donc aucun coût supplémentaire.
Utilisation de l’app
Combien de personnes peuvent interagir simultanément sur la plateforme ?
SB : La plateforme intègre une fonctionnalité d’édition collaborative en temps réel. Par conséquent, il n’y a aucune limite quant au nombre de personnes pouvant interagir simultanément.
Personnalisation
Est-il possible d’avoir une personnalisation totale de l’application avec le branding et le chart code de l’entreprise ?
SB : Tel que Synchroboard™ a été conçu, une personnalisation complète est très facilement réalisable.
Est-il possible d’adapter la structure de l’application aux besoins spécifiques de gestion de projet que nous avons définis ?
SB : Via un menu, il est possible de paramétrer la structure du board (par exemple, une timeline variable) ainsi que les couleurs des entités ou des participants. Cependant, les autres éléments, comme les étiquettes, ne sont pas paramétrables, sauf à travers une modification du code.
Ajout de tâches et de milestones
Quelle flexibilité Synchroboard™ offre-t-il après l’importation du diagramme de Gantt si le projet subit des modifications ?
SB : Synchroboard™ permet l’ajout de jalons ou de tâches supplémentaires.
Gestion de la qualité
En quoi la qualité a à voir avec la gestion de projet ?
SB : L’absence de qualité impacte la prévisibilité de la date de livraison ainsi que le coût du projet, du produit, et à l’avenir, du démarrage en production.
Pour toutes ces raisons, la qualité fait partie intégrante de l’écosystème Synchroboard™, tout comme elle l’est dans le modèle du Toyota Production System et du Toyota Product Development System, auxquels Synchroboard™ se réfère.